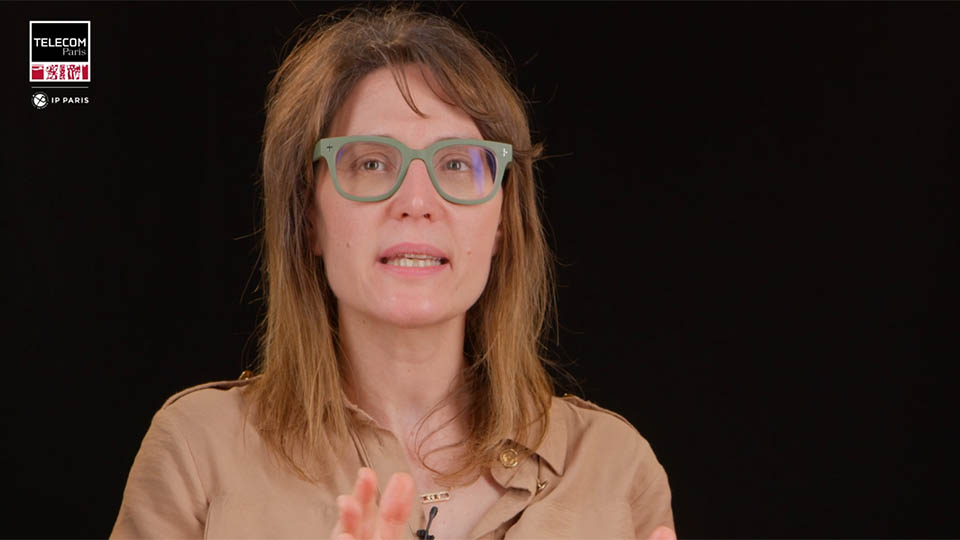Exploration du risque de perte de biodiversité :
Enjeux, mesures et rôle du numérique
Imène Ben Rejeb Mzah, diplômée Télécom Paris/Oxford, BNP Paribas, juillet 2025

Propos recueillis par Isabelle Mauriac
Podcast
Retrouvez cette interview en format audio dans le cadre des podcasts Télécom Paris Ideas :
Podcast enregistré le 15 mai 2025 par Michel Desnoues, Télécom Paris
Ainsi qu’en vidéos
L’importance de ce risque
Nous commençons à être familiers avec la notion de risque climatique et toutes les conséquences néfastes qu’il a sur l’économie et les activités financières. Le risque de perte de biodiversité est un peu moins connu du grand public. Selon une étude récente du Forum économique mondial, plus de 50% du PIB mondial dépendent modérément à fortement des services écosystémiques, donc des bénéfices de la biodiversité. En partant de ce constat, le risque de perte de biodiversité n’est pas mineur pour l’économie. C’est pourquoi nous devons commencer à nous y intéresser et à quantifier ce risque pour essayer de se préparer et de limiter ses effets.
Le concept de biodiversité est une notion complexe qui englobe un ensemble de dimensions. La première dimension est la variété d’espèces, d’écosystèmes et de gènes. La deuxième est le fait qu’elle fonctionne comme un réseau. Ces écosystèmes vont interagir ensemble. La troisième dimension sont les fonctions écosystémiques, donc tous les services que la biodiversité apporte à l’humanité. Il est possible de se nourrir grâce à la biodiversité, de bénéficier de l’eau propre grâce à la biodiversité…
La biodiversité nous soutient dans l’ensemble de nos besoins vitaux.
Oui, c’est effectivement une question très complexe. Le concept de biodiversité recouvre un ensemble de dimensions et la perte de biodiversité est un mal qui a plusieurs symptômes. Pour vous donner une idée, nous avons fait un sondage au sein d’une population de data scientists, à qui il était demandé : quelle est la première image à laquelle vous pensez quand on évoque la perte de biodiversité ? Les réponses étaient très différentes malgré la population relativement homogène sondée. Certains ont pensé aux épisodes de blanchissement massif que subit la barrière de corail australienne, une détérioration provoquée par le changement climatique. D’autres à la destruction d’une partie de la forêt vierge amazonienne. D’autres encore au syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles mellifères observé en Europe, qui est un phénomène de mortalité anormal et récurrent des colonies d’abeilles domestiques. Certains ont mentionné la disparition du dauphin d’eau douce du fleuve Yangtze en Chine dans les années 2000, du fait de l’action humaine.
Comment mesurer ce risque ?
C’est une question assez complexe. La première question est : quelle est l’unité ? Existe-t-il une unité physique comme pour mesurer la quantité de gaz à effet de serre ? Parce qu’à un moment, cette question-là se pose pour le changement climatique : comment mesurer dans une seule unité l’impact de différentes entreprises qui peuvent émettre des gaz différents ? Il existe différents gaz à effet de serre, dont évidemment, le plus abondant est le dioxyde de carbone, mais aussi le méthane, le protoxyde d’azote, etc. Il nous fallait une seule unité pour agréger ces différentes émissions. Les scientifiques ont travaillé dur pour trouver des facteurs de conversion nous permettant de convertir les différents gaz en équivalent CO2. C’est de là que l’empreinte carbone est née. Elle permet de comparer les émissions des entreprises entre elles grâce à cette unité qui agrège les différents gaz.
Mean Species Abundance (MSA : abondance moyenne des espèces), Potentiality-Disappeared-Fraction-of-Species (PDF : la part d’espèces potentiellement disparues) et Biodiversity-Intactness Index (BII : Indice d’intégrité de la biodiversité), trois métriques qui permettent de mesurer l’intégrité des écosystèmes. Nous avons essayé de comprendre les caractéristiques intrinsèques de ces indicateurs et rédigé un article qui les décrit et qui compare les avantages et inconvénients de chacun.
Modéliser l’un de ces indicateurs revient à quantifier les pressions qui s’exercent sur l’écosystème étudié. Ces pressions sont réparties en cinq catégories, selon l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), l’équivalent du GIEC pour la problématique de la biodiversité :
- l’usage et le changement d’usage des sols,
- le changement climatique,
- la pollution,
- la sur-exploitation des ressources,
- les espèces invasives.
Nous allons modéliser l’impact de ces pressions sur les écosystèmes avec des modèles de cause à effet. Chaque unité va avoir un ou plusieurs modèles qui permettent de quantifier la perte de biodiversité en fonction de ces pressions. La quantité de ces pressions est prise comme entrée, puis l’impact sur la biodiversité exprimée dans une des unités que je décrivais (MSA, PDF ou BII) grâce à ces modèles de cause à effet.
Il faut arriver à quantifier la quantité de pression appliquée par l’entreprise. Par exemple, pour simplifier, l’une des pressions qui s’exerce sur la biodiversité est le changement climatique. L’unité de cette pression est la quantité de gaz à effet de serre, désormais très bien mesurée. Il faut faire la même chose sur les autres pressions.
Aujourd’hui, nous travaillons sur les différentes méthodologies permettant de calculer ces empreintes. Aujourd’hui il en existe plusieurs, il y a même plusieurs unités possibles. Nous sommes en train de les étudier, de faire des recherches sur ce sujet. Ensuite il nous faudra de la donnée en input pour pouvoir modéliser l’empreinte des différentes entreprises. Cette donnée n’est que rarement disponible aujourd’hui.
Le premier article décrit les indicateurs d’intégrité des écosystèmes et partage les conclusions de mois de travaux de recherche sur les unités qu’il est possible d’utiliser pour l’empreinte écologique, donc la mesure d’empreinte de biodiversité. Il va par exemple décrire les avantages et inconvénients des unités MSA, PDF et BII.
Le deuxième article s’intéresse aux métriques d’espèces et en décrit deux : la première, Rarity Weighted Richness (RWR), permet de mesurer la richesse d’un écosystème en espèces rares ; la deuxième, Species Threat Abatement and Restoration (STAR), permet de mesurer la richesse d’un écosystème en espèces menacées ou vulnérables.
Le rôle du numérique
Dans la première catégorie d’usages du numérique se trouve la manipulation de grandes bases de données qui recensent les résultats des échantillons prélevés par les écologues des différents laboratoires du monde entier, Elles sont utilisées pour calibrer les modèles « pression – impact » utilisés pour modéliser les indicateurs d’intégrité des écosystèmes dont je parlais précédemment. L’IoT, Internet des Objets, est aussi utilisée dans cette première catégorie de collecte et de traitement de ces données.
Différents appareils, capteurs et systèmes permettent aux chercheurs et aux écologues de collecter des données en temps réel sur différents paramètres écologiques comme la température, l’humidité, la qualité de l’air et les dynamiques des populations des différentes espèces auxquelles ils s’intéressent. C’est ce qui leur permet de comprendre et d’analyser les complexités des écosystèmes de manière plus efficace. Autre exemple de cette première catégorie d’usage du numérique, l’imagerie satellite. Les données satellites sont utilisées pour monitorer la déforestation. Il est possible d’identifier des catégories d’utilisation des sols avec une très haute résolution et de surveiller le trafic maritime dans les aires marines protégées.
Dans la deuxième catégorie qui est la modélisation ainsi que la quantification, il est possible de calibrer et de faire tourner des modèles pression-impact pour calculer l’empreinte biodiversité. Nous faisons aussi de la manipulation de données géospatiales pour vérifier si des projets se situent dans des zones de biodiversité protégées. Cela va alimenter l’évaluation des risques liés à la biodiversité de ces projets. Enfin, l’intelligence artificielle permet de traiter les images satellite ou d’affiner les modèles et compléter les données manquantes. Ce sont quelques exemples d’utilisation du numérique dans le cadre de la quantification du risque de biodiversité.
Comment accompagner les entreprises ?
Ainsi notre prochain sur le sujet va traiter des pressions qui s’exercent sur la biodiversité marine : nous allons passer en revue l’ensemble des pressions sur la biodiversité marine et voir quel est le degré de maturité de la modélisation scientifique de ces différentes pressions.
Beaucoup de recherche est nécessaire pour pouvoir couvrir l’ensemble des pressions qui s’exercent sur la biodiversité marine. Aujourd’hui, tous les outils ne permettent pas de quantifier, même de manière théorique, les pressions qui s’exercent sur la biodiversité marine. Et ce n’est qu’un exemple. L’étape suivante sera de travailler sur la collecte des données pour alimenter ces modèles. Les données climatiques sont désormais assez solides pour les secteurs les plus émetteurs. Elles sont reportées directement ou elles peuvent être calculées d’une manière assez précise à partir des données des actifs émetteurs. Mais ce n’est pas le cas des données environnementales nécessaires au calcul des indicateurs de biodiversité au niveau de l’entreprise.
Pour prendre un exemple, la pression « usage et changement d’usage des sols » est l’une de celles qui impacte le plus la biodiversité. Il nous faudrait pour chacun des actifs de l’entreprise, sa quantité d’utilisation des sols, son état de biodiversité au début de l’exercice et à la fin de l’exercice d’évaluation. Il nous faut cette donnée aussi pour toute la chaîne d’approvisionnement parce que nous intéressons à l’impact direct de l’entreprise mais aussi à son impact indirect.
Des progrès sont possibles avec l’imagerie satellite comme je l’expliquais tout à l’heure, afin d’évaluer les niveaux d’intégrité des écosystèmes impactés aux différentes dates nécessaires à l’exercice ; encore faut-il pouvoir localiser les différents actifs de l’entreprise ainsi que ceux de sa chaîne d’approvisionnement.
Il s’agit là de l’exemple d’une seule entrée qui nous manque, mais il en manque beaucoup d’autres pour évaluer de manière satisfaisante l’empreinte biodiversité d’une entreprise. Autrement dit, en l’absence de ce type de données précises au niveau de l’entreprise, il n’y a pas d’autre choix que de recourir à des moyennes géographiques et sectorielles, ce qui permet d’avoir une idée assez grossière de l’impact mais non de discriminer les entreprises.
Vidéos
Quantifier l’empreinte biodiversité
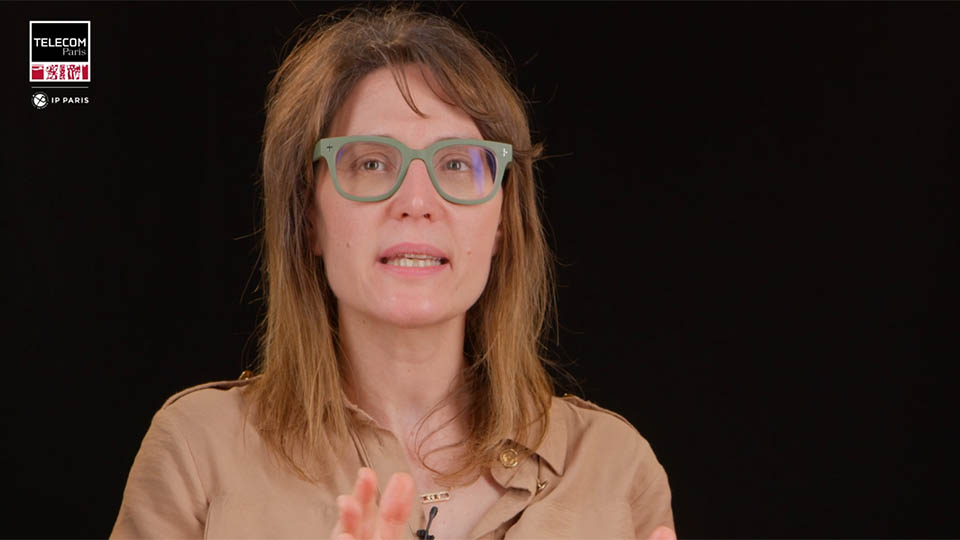
L’érosion de la biodiversité